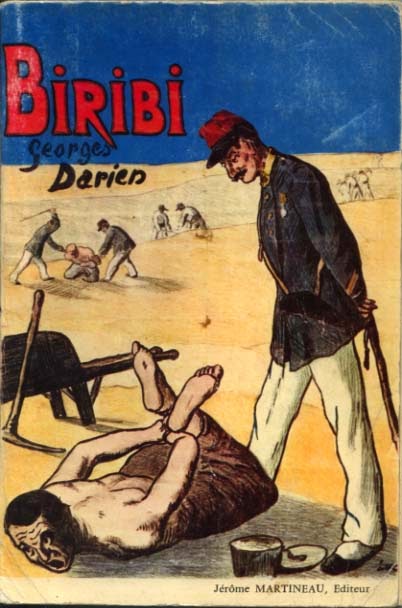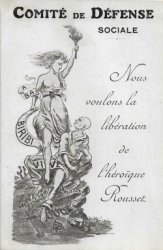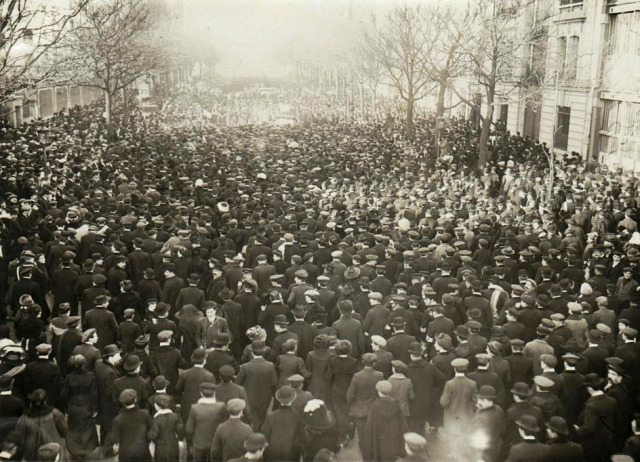Une
épidémie de peste particulièrement meurtrière eut lieu à Londres en
1655, suivie par un incendie dévastateur aussitôt après.
Avant de poursuivre, il n’est pas inutile de rappeler que la peste est une bactérie, « yersinia pestis*« , découverte en 1894 par Alexandre Yersin*, un médecin de l’Institut Pasteur.

Cette bactérie se trouve
généralement chez les petits mammifères et les puces dont ils sont les
hôtes. Il y a deux sortes de peste:
- la bubonique, la plus courante, uniquement contagieuse si l’on touche au bubon, elle affecte les ganglions lymphatiques;
- la pulmonaire, très contagieuse en transmettant d’une personne à l’autre les gouttelettes respiratoires en suspension dans l’air et qui entraine la mort très rapidement.
Quand la maladie est traitée rapidement, des injections d’antibiotiques peuvent la stopper.

Les
autorités londoniennes savaient qu’une épidémie de peste sévit aux Pays
Bas. Une quarantaine sévère a donc été mise en oeuvre dans les ports
anglais, d’autant plus rigoureusement que l’Angleterre était en guerre
avec les Pays Bas, pour la seconde fois et pour une affaire de
suprématie sur les lignes maritimes commerciales.
Pourtant, des
négociants peu scrupuleux vont réussir à débarquer des ballots de soie
ou de fourrures. L’épidémie serait partie de ces marchandises.
La
première victime, Margaret Ponteus, serait décédée le 12 avril 1665. La
maladie va se répandre près vite, partant des quartiers les plus pauvres
pour atteindre le centre de Londres.
Ce sont donc les déshérités,
les mendiants, les ouvriers, les domestiques qui seront les plus
touchés. Daniel Defoe dans son livre écrit: « Les pauvres sont les
principales victimes de l’épidémie. Dépourvus d’épargne, la perte des
revenus du travail les conduit à accepter les jobs qui demeurent car
essentiels ou qui sont en forte demande (infirmières, gardiens de
maisons contaminées, croque-morts. » (1)

Les
mois de mai, de juin et de juillet sont anormalement chauds, sans qu’il y
ait eu forcément de relations de cause à effet. Le nombre de morts
augmente chaque semaine, jusqu’à 2 à 3000. En septembre 1665, au pic de
l’épidémie, on dénombrera plus de 7000 morts dans la même semaine.
Dans son journal, Samuel Pepys * écrit: « Je
me prépare à déménager à Woolwich, la peste ayant augmenté cette
semaine au-delà de toute prévision: plus de six mille morts » (31 août).
À
cette époque, la capitale anglaise comptait 500 000 habitants. Certains
historiens estiment que ce chiffre est exagéré. Une grande partie de la
population va fuir la ville, les plus fortunés bien évidemment qui se
réfugieront à la campagne. Le roi Charles II, sa famille et sa cour
fuient leur palais.
« Par ordre du roi, ces quartiers étaient
condamnés, et il était défendu à toute personne, sous peine de mort, de
pénétrer dans leurs affreuses solitudes. » (2)
Parmi les
autorités, ne restent à Londres que le lord maire et les conseillers
municipaux. Ils organisent le nettoyage de la ville: évacuer tout les
cadavres restés dans les maisons, évacuer les carcasses de chiens et de
chats, ces derniers étant réputés propager la maladie, isoler les
malades et leur famille, ce qui aura pour effet de contaminer ceux qui
ne le sont pas.
Les rues de Londres sont désertes puisque ce qui
reste des londoniens encore présents n’ont plus le droit de sortir. Un
corps d’inspecteurs, de médecins et d’infirmières est créé, chargé de
visiter les malades, de s’assurer qu’ils ne meurent pas de faim. Les
membres de ce corps, quand ils se déplacent, ont à la main une longue
baguette rouge pour que les passants ne les contactent pas.

L’interdiction
de sortir est alors considérée par les juristes anglais comme contraire
à la loi qui permet à chacun de se déplacer librement. Daniel Defoe,
dans « Journal de l’année de la peste » publié anonymement en 1722, soit
soixante sept après l’épidémie. Né en 1661, il n’avait donc que quatre
ans et en conséquence, il ne peut s’agir de souvenirs personnels.
Dans
cet ouvrage, à travers le narrateur, il s’en prend aux charlatans, aux
médecins qui vendaient des médicaments plus dangereux que la peste; aux
curés qui ont abandonné leurs paroissiens, mais aussi aux quakers, aux
presbytériens: « Les interprétations religieuses fleurissent, mais
aussi toutes sortes de superstitions. Charlatans, prophètes,
astrologues, guérisseurs, escrocs s’en donnent à cœur-joie. »(3) Il ajoute: « « Dieu n’a pas besoin de la peste pour affirmer son pouvoir »
Le
narrateur de son livre doute de l’efficacité de la méthode imposée par
les autorités: pour des raisons morales, mais surtout politiques:
empêcher les londoniens de se déplacer librement, encourageant la
corruption, la violence, les crimes. Il rejoint ainsi les contempteurs
qui avaient exprimé les mêmes réserves à l’époque de l’épidémie.

Les
différents états qui n’avaient pas été touchés par la peste comme
l’Espagne ou l’Italie, avaient fermé leurs frontières, empêchant ainsi
le moindre commerce avec l’Angleterre. Les différentes entreprises,
surtout les manufactures, qui travaillaient pour l’exportation, se
retrouvèrent en faillite et durent licencier leurs ouvriers, augmentant
ainsi une pauvreté déjà bien trop présente.
Différents
moyens de combattre l’épidémie furent mis en place, sans réels succès:
les feux de plein air censés purifier l’air; le tabac à qui l’on prêtait
des vertus médicinales au point que les autorités allèrent jusqu’à
obliger les écoliers à fumer, ceux qui refusaient étant alors fouettés.
Le vinaigre, l’eau de rose et certaines plantes aromatiques étaient également recommandées pour purifier l’air des habitations.
Si la
peste a sévit principalement à Londres, la campagne environnantes ne fut
pas pour autant épargnée. Certains villages perdirent une grande partie
de leur population.
Ajoutées aux milliers de victimes londoniennes,
ces pertes eurent des conséquences démographiques importantes: en 1650,
5,2 millions d’habitants peuplaient l’Angleterre, en 1680, seulement
4,9 millions.

L’épidémie a très vite disparue. Sans que l’on en connaisse les véritables raisons, comme cela était le cas à cette époque.
Certains
chroniqueurs de cette époque ont attribué cette disparition au grand
incendie qui a ravagé la capitale anglaise en septembre 1666. Cet
incendie aurait éradiqué rats et bactéries ainsi que les habitations
insalubres où la peste avait pu s’installer. Cette hypothèse n’est sans
doute pas à rejeter, tant il est vrai que les flammes ont détruit une
bonne partie de Londres.
Le feu serait parti d’une
boulangerie tenue par Thomas Farringera. Ce dernier se réfugia alors sur
les toits, sans pouvoir emmener sa fille qui mourra dans les flammes.
Pendant
quatre jours, le feu, alimenté par des vents violents, a détruit quinze
mille maisons, palais, bâtiments publics, églises, y compris la
cathédrale St Paul.
Les constructions étaient construites
majoritairement en bois, avec des foyers ouverts et des fours, des
dépôts de bitume, de graisse, de suif, de charbon. Pas de services
incendie digne de ce nom. Il existait bien des fourgons d’incendie,
montés sur roue ou sur patins, mais plutôt inefficaces car peu
maniables. Chaque maison était équipée d’un crochet à incendie, très
efficace, la destruction des habitations étant alors la méthode employée
pour circonscrire les incendies. Ce qui n’était pas toujours facile car
les rues sont très étroites et souvent encombrées.
Comme il arrive
souvent en pareil cas, des rumeurs de complots, d’invasion par des
armées étrangères circulaient parmi les londoniens, rumeurs bien
évidemment incontrôlables et incontrôlées: 50 000 immigrants français et
hollandais auraient été prêts à envahir la ville. Aussi, des étrangers
furent frappés par des foules apeurées et inquiètes.
Au quatrième jour, les vents se calmerènt et l’incendie s’éteignit relativement vite.
Il
n’a quasiment pas été possible de dresser un bilan exact du nombre de
victimes, mais il est certainement bien plus élevé que les huit
personnes annoncées par les autorités.

La peste,
puis l’incendie ont laissé des traces profondes dans les mémoires
anglaises. En 2016, pour marquer le 350ème anniversaire du « Great
Fire », une maquette de 120 mètres représentant le Londres du XVII ème
siècle fut brulée sur la Tamise.
Le projet de reconstruction de la
cité par l’architecte Christopher Wren aurait dû être ambitieux, mais le
roi voulut d’abord reconstruire les églises.
Faute de financements
les habitations furent reconstruites en briques, aux mêmes endroits. Les
rues ont été légèrement élargies, sans pour autant donner lieu à de
larges avenues.
Londres
s’est bien évidemment relevé de ces deux catastrophes. La ville que l’on
connait aujourd’hui, architecture à la fois baroque et futuriste, a
traversé les siècles, mélangeant la misère la plus abominable et la
richesse la plus extravagante. Lire ou relire Charles Dickens nous
rappelle, si besoin était, que la Tamise n’a jamais été « un long fleuve
tranquille. »
Le « blitz »*,
pendant plus de neuf mois, a ravagé, entre autre, la capitale
britannique et fait plusieurs milliers de victimes et fait déplacer des
milliers de londoniens.

Londres,
ancienne capitale de l’Empire britannique, mais toujours capitale du
Royaume Uni et du Commonwealth, le Londres de Winston Churchill, des
Rolling Stones, de Madame Thatcher ou de Elisabeth II n’a pas fini de nous étonner.

(1) in https://www.revuedesdeuxmondes.fr/journal-de-lannee-de-la-peste-daniel-defoe-reveille-langleterre/
(2) in « le roi peste » de Edgar Allan Poe, Contes, essais, poèmes, éditions Robert Laffond, collection Bouquins, 2005, page 187.
(3) in https://www.revuedesdeuxmondes.fr/journal-de-lannee-de-la-peste-daniel-defoe-reveille-langleterre/
(2) in « le roi peste » de Edgar Allan Poe, Contes, essais, poèmes, éditions Robert Laffond, collection Bouquins, 2005, page 187.
(3) in https://www.revuedesdeuxmondes.fr/journal-de-lannee-de-la-peste-daniel-defoe-reveille-langleterre/